Le 3 mars 1802, la Classe des Sciences morales et politiques de l’Institut choisit un sujet de concours intitulé « Quelle a été l’influence de la Réformation de Luther sur la situation politique et le progrès des Lumières ».
Ce choix est politique. L’été précédent, Pie VII et Bonaparte ont signé un Concordat déclarant la religion catholique « religion de la majorité des Français ». C’est une déception pour les protestants et les progressistes de l’Institut. Alors que le « parti catholique » triomphe avec la publication du Génie du Christianisme et la ratification du Concordat suivie d’une messe solennelle à Notre-Dame, La Décade philosophique, dirigée par le protestant Jean-Baptiste Say, publie dans le même numéro le texte du Concordat et l’annonce du concours. Bonaparte, qui vient d’épurer le Tribunat en évinçant les idéologues, réforme l’Institut en janvier 1803 : la Classe des Sciences morales est supprimée et ses membres répartis dans d’autres classes.
C’est la Classe d’Histoire et de littérature ancienne qui décerne le prix en mars 1804. Six des sept candidats ont fait l’éloge de la Réforme. Le lauréat est Charles de Villers, officier lorrain catholique de 39 ans émigré à Göttingen où il avait été séduit par la culture allemande ; mais son livre sur la philosophie de Kant, publié en 1801 avec une dédicace à l’Institut, avait déplu aux matérialistes de la Classe des Sciences morales. Villers, qui bénéficie de l’anonymat du concours, n’avait pour appui que le luthérien Georges Cuvier qui préside la Classe des Sciences et quelques historiens protestants de Strasbourg. Il s’est lié avec Benjamin Constant, Germaine de Staël et l’ambassadeur de Berne Stapfer.
 Portrait de Charles de Villers par Friedrich Carl Gröger, 1809. Portraitiste renommé d’Allemagne du Nord.
Portrait de Charles de Villers par Friedrich Carl Gröger, 1809. Portraitiste renommé d’Allemagne du Nord.
(wikipedia commons)
Lire la suite


 Il est des artistes dont l’œuvre rayonne dans le temps sans que leur vie soit connue. C’est le cas de Claude Goudimel, dont les réformés chantent chaque dimanche les Psaumes.
Il est des artistes dont l’œuvre rayonne dans le temps sans que leur vie soit connue. C’est le cas de Claude Goudimel, dont les réformés chantent chaque dimanche les Psaumes. Portrait de Charles de Villers par Friedrich Carl Gröger, 1809. Portraitiste renommé d’Allemagne du Nord.
Portrait de Charles de Villers par Friedrich Carl Gröger, 1809. Portraitiste renommé d’Allemagne du Nord.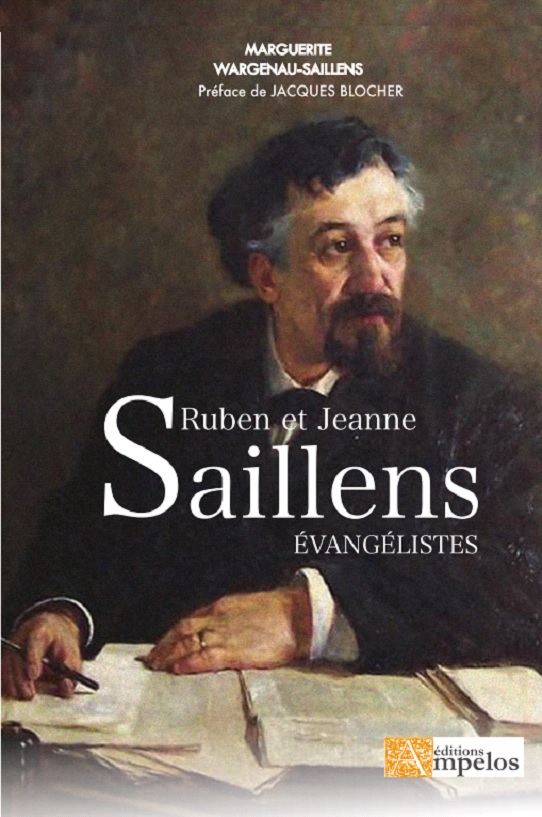 Salut montagnes bien aimées,
Salut montagnes bien aimées,