par Gabrielle Cadier
Quand on parle des pays du Refuge huguenot, on ne cite quasiment jamais le royaume de Danemark-Norvège. Pourquoi cette destination n’a-t-elle pas suscité plus d’études ?
En effet, malgré la forte hostilité des évêques luthériens qui considéraient les réformés comme plus dangereux que les catholiques, des centaines de réfugiés français arrivèrent au Danemark et y firent souche. Ils furent attirés par la politique du roi Christian V qui, entre janvier et avril 1685 (c’est-à-dire avant la révocation), promettait des lettres de privilèges fiscaux.
 Quant à la reine Charlotte-Amélie, (Charlotte Amélie de Danemark par Johann Salomon Wahl, localisation actuelle inconnue. Wikipédia, Reproduction public domain in the United States) une princesse réformée de Hesse, quand elle fit construire un temple d’abord destiné à sa Maison, elle l’ouvrit aussi aux réfugiés français. Elle organisa les deux consistoires, l’allemand et le français, fit construire les deux presbytères, et fixa les règles de vie commune. Aujourd’hui encore, l’Église réformée de Copenhague fonctionne selon les voeux de cette reine. Et c’est grâce aux registres de mariages et de baptêmes de cette Église que l’on peut connaître précisément une grande partie de ces réfugiés, leur région d’origine et leur profession. Pour arriver au Danemark, soit ils passaient par la voie maritime et c’est le chemin que prirent majoritairement ceux qui quittaient la Guyenne, le Poitou, les Charentes, la Normandie etc… , soit ils passaient par la voie terrestre, gagnaient la Suisse et de là les principautés allemandes. Quelle que soit la voie choisie, on remarque que le Danemark est rarement une destination première. Les réfugiés ont souvent séjourné dans un autre pays avant de s’installer à Copenhague, là où était la Cour. Quant à leurs professions, en dehors des officiers intégrés dans l’armée et la marine danoise, ce sont essentiellement les métiers du luxe, de la mode et de la bouche qui ont prospéré. Et la profession qui a eu le plus de représentants, c’est celle de perruquier. On peut citer les noms d’environ 25 !
Quant à la reine Charlotte-Amélie, (Charlotte Amélie de Danemark par Johann Salomon Wahl, localisation actuelle inconnue. Wikipédia, Reproduction public domain in the United States) une princesse réformée de Hesse, quand elle fit construire un temple d’abord destiné à sa Maison, elle l’ouvrit aussi aux réfugiés français. Elle organisa les deux consistoires, l’allemand et le français, fit construire les deux presbytères, et fixa les règles de vie commune. Aujourd’hui encore, l’Église réformée de Copenhague fonctionne selon les voeux de cette reine. Et c’est grâce aux registres de mariages et de baptêmes de cette Église que l’on peut connaître précisément une grande partie de ces réfugiés, leur région d’origine et leur profession. Pour arriver au Danemark, soit ils passaient par la voie maritime et c’est le chemin que prirent majoritairement ceux qui quittaient la Guyenne, le Poitou, les Charentes, la Normandie etc… , soit ils passaient par la voie terrestre, gagnaient la Suisse et de là les principautés allemandes. Quelle que soit la voie choisie, on remarque que le Danemark est rarement une destination première. Les réfugiés ont souvent séjourné dans un autre pays avant de s’installer à Copenhague, là où était la Cour. Quant à leurs professions, en dehors des officiers intégrés dans l’armée et la marine danoise, ce sont essentiellement les métiers du luxe, de la mode et de la bouche qui ont prospéré. Et la profession qui a eu le plus de représentants, c’est celle de perruquier. On peut citer les noms d’environ 25 !

 Jeanne d’Albret quitte Nérac le 6 septembre 1568 avec ses deux enfants, Henri et Catherine.
Jeanne d’Albret quitte Nérac le 6 septembre 1568 avec ses deux enfants, Henri et Catherine.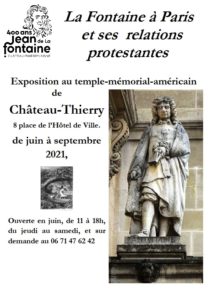
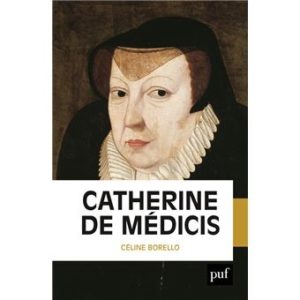 Catherine de Médicis est une des grandes figures féminines du XVIe siècle européen. Né à Florence en 1519, elle est descendante d’une des plus riches familles italiennes dont la puissance a été forgée sur le négoce et la banque. Et c’est son nom qui lui permet de s’unir en 1533 à la maison des Valois.
Catherine de Médicis est une des grandes figures féminines du XVIe siècle européen. Né à Florence en 1519, elle est descendante d’une des plus riches familles italiennes dont la puissance a été forgée sur le négoce et la banque. Et c’est son nom qui lui permet de s’unir en 1533 à la maison des Valois.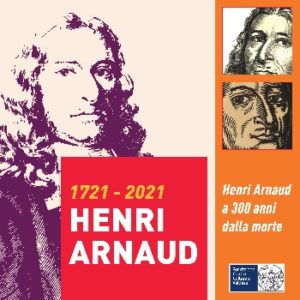 Trois cents ans se sont écoulés depuis la mort d’Henri Arnaud, colonel et pasteur, qui dirigea la « Glorieuse rentrée », en 1689. Après deux années d’exil forcé en Suisse, il ramena ces Vaudois dans leurs vallées, reconquérant ainsi le droit de vivre sur leurs terres en pratiquant une confession religieuse, autre que celle du Duc de Savoie.
Trois cents ans se sont écoulés depuis la mort d’Henri Arnaud, colonel et pasteur, qui dirigea la « Glorieuse rentrée », en 1689. Après deux années d’exil forcé en Suisse, il ramena ces Vaudois dans leurs vallées, reconquérant ainsi le droit de vivre sur leurs terres en pratiquant une confession religieuse, autre que celle du Duc de Savoie. Toute velléité de Réforme en Espagne fut impitoyablement éradiquée par l’Inquisition
Toute velléité de Réforme en Espagne fut impitoyablement éradiquée par l’Inquisition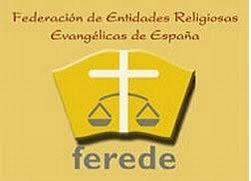 seul représentant par confession – autre que juive, musulmane ou catholique – la poussa à œuvrer à la création d’une Fédération, la FEREDE, regroupant les églises protestantes, rejointes par les orthodoxes et les adventistes. Toutes Eglises confondues, l’Espagne compte un million de protestants sociaux dont 300 000 pratiquants. L’Eglise protestante espagnole est une église unie
seul représentant par confession – autre que juive, musulmane ou catholique – la poussa à œuvrer à la création d’une Fédération, la FEREDE, regroupant les églises protestantes, rejointes par les orthodoxes et les adventistes. Toutes Eglises confondues, l’Espagne compte un million de protestants sociaux dont 300 000 pratiquants. L’Eglise protestante espagnole est une église unie Le 16 décembre 1620, il vient juste d’y avoir 400 ans, Guillaume de Nautonier s’éteint dans son château de Castelfranc, situé sur la commune de Montredon-Labessonié, dans le département du Tarn.
Le 16 décembre 1620, il vient juste d’y avoir 400 ans, Guillaume de Nautonier s’éteint dans son château de Castelfranc, situé sur la commune de Montredon-Labessonié, dans le département du Tarn.