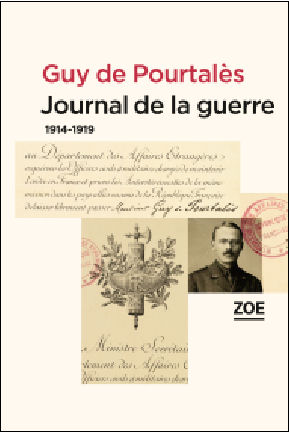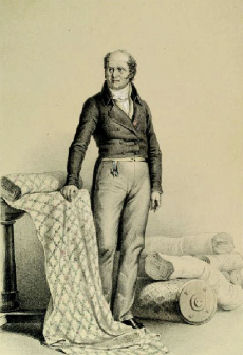A Blérancourt, situé à 15 kms de Noyon (Oise), la ville natale de Calvin, le musée de l’amitié franco-américaine a rouvert après plusieurs années de rénovation. Ce musée dédié à l’amitié franco-américaine a été fondé par Anne Morgan qui mena pendant la 1ère guerre mondiale une action sociale et de reconstruction auprès des populations civiles de l’Aisne de 1917 à 1924.
A Blérancourt, situé à 15 kms de Noyon (Oise), la ville natale de Calvin, le musée de l’amitié franco-américaine a rouvert après plusieurs années de rénovation. Ce musée dédié à l’amitié franco-américaine a été fondé par Anne Morgan qui mena pendant la 1ère guerre mondiale une action sociale et de reconstruction auprès des populations civiles de l’Aisne de 1917 à 1924.
Anne Morgan était la richissime héritière du magnat des chemins de fer, de l’acier et banquier, John Pierpont Morgan, son père, mort d’une crise cardiaque en 1913. Elle est née en 1873, marquée par une éducation assez rigide venant de son arrière grand-père, le pasteur unitarien John Pierpont dont les prêches contre l’esclavage (aboli aux US seulement en 1865) et la reconnaissance des droits de l’homme furent célèbres. Son père, engagé dans l’église épiscopalienne, était déjà très attentif aux questions sanitaires et à la lutte contre la tuberculose dès 1903. Anne, d’un caractère volontaire et indépendant s’occupe des ouvroirs de la paroisse, puis participe aux mouvements philanthropiques féminins, milite pour le sort des ouvrières et femmes des milieux ouvriers, la création des premières résidences sociales en Amérique.