par Christiane Guttinger
 Toute velléité de Réforme en Espagne fut impitoyablement éradiquée par l’Inquisition[1], et cependant une Bible en espagnol publiée à Amsterdam en 1602[2].
Toute velléité de Réforme en Espagne fut impitoyablement éradiquée par l’Inquisition[1], et cependant une Bible en espagnol publiée à Amsterdam en 1602[2].
L’Eglise protestante espagnole (IEE, Iglesia evangelica espaniola), ne sortit ainsi de la clandestinité qu’en 1869, fondée l’année où une nouvelle constitution monarchique et libérale, accorda la liberté de culte. Sa première assemblée générale se tint à Séville en 1872, sous la dénomination d’Église chrétienne espagnole, devenue au XXe siècle, Eglise évangélique espagnole.
En 1980, après le rétablissement de la monarchie constitutionnelle, l’Etat ne reconnaissant qu’un 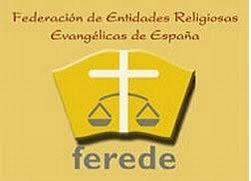 seul représentant par confession – autre que juive, musulmane ou catholique – la poussa à œuvrer à la création d’une Fédération, la FEREDE, regroupant les églises protestantes, rejointes par les orthodoxes et les adventistes. Toutes Eglises confondues, l’Espagne compte un million de protestants sociaux dont 300 000 pratiquants. L’Eglise protestante espagnole est une église unie[3] qui regroupe réformés, presbytériens, congrégationalistes, méthodistes et luthériens issus de missions étrangères présentes depuis la fin du XVIIIes, et compte 3 000 membres. Sa confession de foi est très proche de la confession de foi suisse.
seul représentant par confession – autre que juive, musulmane ou catholique – la poussa à œuvrer à la création d’une Fédération, la FEREDE, regroupant les églises protestantes, rejointes par les orthodoxes et les adventistes. Toutes Eglises confondues, l’Espagne compte un million de protestants sociaux dont 300 000 pratiquants. L’Eglise protestante espagnole est une église unie[3] qui regroupe réformés, presbytériens, congrégationalistes, méthodistes et luthériens issus de missions étrangères présentes depuis la fin du XVIIIes, et compte 3 000 membres. Sa confession de foi est très proche de la confession de foi suisse.

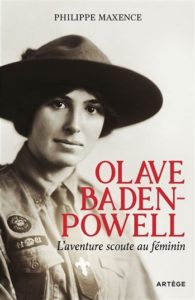 Il y a quelques années, lors des commémorations du centenaire du scoutisme, la personnalité de Robert Baden-Powell fut largement évoquée. On sait qu’il s’était rendu célèbre dans tout l’Empire britannique par son action durant la seconde Guerre des Boers en 1899-1900, au cours de laquelle il avait fait la preuve que des jeunes étaient tout à fait capables de réussir une mission, pourvu qu’on leur fasse confiance.
Il y a quelques années, lors des commémorations du centenaire du scoutisme, la personnalité de Robert Baden-Powell fut largement évoquée. On sait qu’il s’était rendu célèbre dans tout l’Empire britannique par son action durant la seconde Guerre des Boers en 1899-1900, au cours de laquelle il avait fait la preuve que des jeunes étaient tout à fait capables de réussir une mission, pourvu qu’on leur fasse confiance.
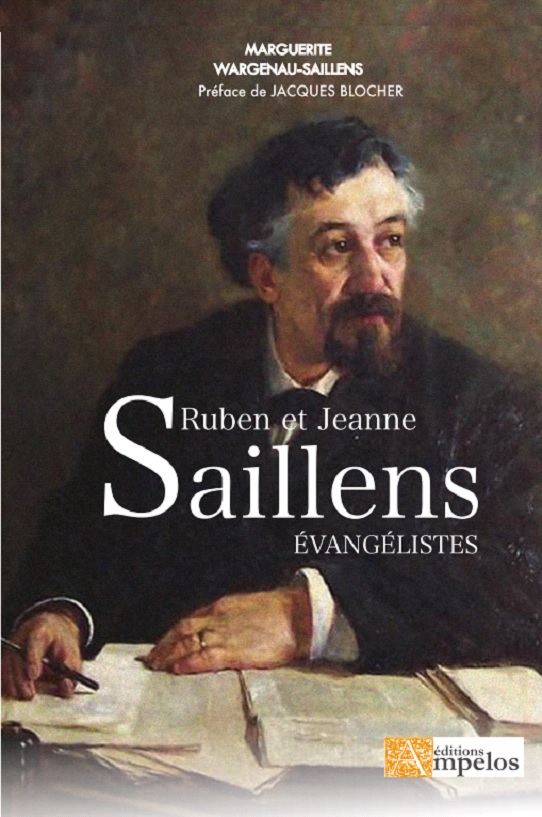 Salut montagnes bien aimées,
Salut montagnes bien aimées,