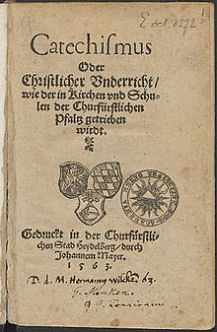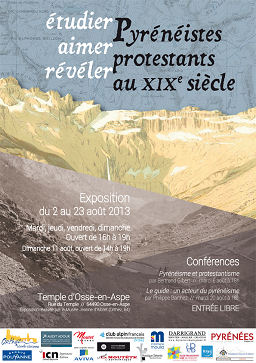Il y a 150 ans, le 1er août 1863 naquit Gaston Doumergue. Saluons l’initiative du Comité créé pour célébrer celui qui demeure à ce jour, le seul protestant à avoir accédé à la Présidence de la République française.
 Né à Aigues-Vives, bourg protestant du Gard depuis la Réforme, il débute comme avocat ; très vite il ressent l’appel du large qui le mène en Indochine et en Afrique du Nord.
Né à Aigues-Vives, bourg protestant du Gard depuis la Réforme, il débute comme avocat ; très vite il ressent l’appel du large qui le mène en Indochine et en Afrique du Nord.
Elu député radical en 1893, succédant à son coreligionnaire et mentor Emile Jamais (député du Gard et secrétaire d’Etat aux colonies), il entame une brillante ascension politique : ministre dès 1902, sénateur, président du Conseil à l’appel de Poincaré (1913), président du Sénat (1923).
Il est élu président de la République en 1924 avec les voix de la droite, contre le candidat du cartel des gauches, Paul Painlevé ; « nul plus que moi ne demeurera au dessus des partis, pour être, entre eux, l’arbitre impartial » déclare-t-il alors.